Rodney Saint-Eloi, « Mille vies comme la mienne » (Québec)
Rodney Saint-Eloi est poète et éditeur. Il dirige les éditions Mémoire d’encrier qu’il a fondées à Montréal en 2003. Il est auteur de nombreux recueils de poésie et directeur d’ouvrages. Sa maison d’édition publie des écrivain.e.s autochtones, antillais.e.s, arabes, africain.e.s, dans leurs langues personnelles et en français, dans l’ambition de « rassembler les continents et les humains pour repousser la peur, la solitude et le repli pour pouvoir imaginer et oser inventer un monde neuf. » Chanter « les bruits du monde » et « l’autre en nous », permettre qu’émerge la parole de l’autre traversent l’écriture et le travail d’éditeur de Rodney Saint-Eloi.
Propos recueillis par Anne-Marie Zucchelli, Montréal, 13 septembre 2021
Un engagement humain nécessaire
Rodney Saint-Eloi, vous écrivez dans Récitatif au pays des ombres, « je me mets à ruminer mille vies comme la mienne ». Un engagement humain nécessaire, exigeant et nourri de votre histoire personnelle soutient votre parole poétique comme votre travail d’éditeur.
Je pense que nous détachons trop l’art de la vie. Les mots s’éloignent de la réalité des choses. Je me sens souvent en décalage et je lutte pour ressembler à ce que je fais. C’est mon combat. Je pense qu’il faut incarner l’idéal, le porter dans notre vie, réduire la distance entre nous-mêmes et nos rêves. Si nous faisons de la poésie, c’est dans notre vie. La poésie est notre manière de respirer, d’habiter, d’être ensemble. La poésie est partout.
Éditer représente un pouvoir immense et symbolique. Nous ne nous rendons pas compte de l’usage que nous faisons de ce pouvoir, d’autant plus que nous sommes des êtres malicieux. Nous sommes dans des nœuds que nous essayons de dénouer et nous faisons semblant d’être des victimes. Pourtant, nous exerçons un certain pouvoir car les mots représentent le pouvoir. Il y a un pouvoir de la parole. Alors, quand nous l’avons, il est important de faire silence et laisser entrer en nous d’autres vies qui n’ont pas cette chance. C’est pourquoi j’ai écrit : « Je me mets à ruminer mille vies comme la mienne ».
Je suis haïtien. Je suis né quelque part et je fais partie d’un collectif. C’est un privilège pour moi de pouvoir lire, écrire et rencontrer des gens comme vous, au lieu d’être resté dans mon village, à chercher du matin au soir l’eau, la nourriture. C’est d’autant plus important pour moi de laisser la place à d’autre vies et d’autres langages. Je suis toujours dans un procès d’altérité. Je ne peux pas simplement être moi-même. Ma vie prend sens quand elle peut servir.
Cependant la pauvreté a de grandes richesses. Elle oblige à ouvrir l’espace, car l’espace est exigu quand on est pauvre. On doit tenir compte de l’autre. On n’a pas de chambre à soi. Lorsqu’on a un frère, il est toujours en face de nous. Les espaces ne sont pas séparés. Il n’y a pas non plus de la nourriture pour les chiens et une autre pour les humains, ni pour les vieux ni pour les jeunes. C’est un mécanisme inventé par l’Occident. L’individu est toujours dans la communauté et au service du village. Ce sens du commun est fort.
Mais lorsque l’on vit sur une île, on n’a qu’une idée : regarder l’autre bord et s’en aller là-bas. Toutes les nouvelles qui viennent de loin paraissent très bonnes. Alors on échappe au destin.
Mais on est toujours lié à cette communauté. C’est à notre tour de dire : si je deviens un héros, c’est pour cette communauté. Ce « chant commun » reste une urgence pour moi.
La femme qui m’a appris à lire, ma grand grand-mère Tida, ne savait pas lire. Lorsque j’ai été admis à l’Académie des lettres du Québec, on m’a demandé d’écrire un texte. J’ai écrit que j’étais le fils de Tida et qu’elle ne savait pas lire. Ce qui nous manque aujourd’hui, c’est la mémoire de ceux qui nous ont précédé, de ces individus-là.
Tida me faisait lire dans la Bible les Psaumes. Je répète toujours le psaume 23 qui a fondé ma vie :
L’Eternel est mon berger : je ne manque de rien.
Il me fait reposer dans de verts pâturages,
Il me dirige près des eaux paisibles.
Il restaure mon âme,
Il me conduit dans les sentiers de la vie juste
A cause de son nom.
Pour moi qui grandissais dans l’abondance de la nature, ce n’était pas fictif. Mais j’ai aussi été élevé sous la dictature qui fait que chaque mot compte. J’ai donc été entouré à la fois de tendresse et de violence.
Quand j’ai découvert que Tida ne savait pas lire, cela a changé pour moi le sens des choses. Les gens qui ne savent pas lire ne sont pas des imbéciles. Il faut les écouter. Tida m’a appris à redéfinir le sens du verbe donner : donner en effet n’est pas donner ce qu’on a ,mais donner ce qu’on n’a pas. Par exemple, chez Tida on ne mangeait pas du poulet les jours de la semaine, pourtant si un visiteur quelconque arrivait un lundi, elle offrait le poulet. De même, elle sortait les draps jamais utilisés et précieusement conservés.
J’ai mené des chantiers d’écriture. C’est un vieux projet monté à l’Institut français de New York avec une amie. Je l’ai fait car j’écris pour rencontrer l’autre et sortir mes propres vulnérabilités. Être moi-même, aller au fond de mes propres désastres. Pour être il faut se mettre à l’écoute des autres. Au Sénégal, on m’appelle wagane « celui qui n’est pas encore vaincu » ou « le guerrier ». À Mingan, au village Innu, les autochtones m’appellent dans leur langue le « gros gros chat », c’est-à-dire le « roi de la forêt ».
L’exil et le voyage
L’exil et le voyage sont des thèmes récurrents dans votre poésie. « J’habite loin de mon île », dites-vous (Nous ne trahirons pas le poème), ou encore « Je scelle mon alliance avec l’exil » (Je suis la fille du baobab brûlé). Vous écrivez que vous vivez « entre-baillé ici-ailleurs » (J’ai un arbre dans ma pirogue). La poésie ouvre une route. Vous vous mettez en marche. Les mots vous guident sur « les sentiers du poème » (Nous ne trahirons pas le poème).
J’habite loin de mon île, ce qui est vrai et faux puisque j’en suis à trois heures et demi d’avion. Mais mon île peut être aussi Dakar ou Gorée. La géographie n’est pas une donnée neutre : c’est aussi une autre manière de regarder le monde.
L’exil a été une nécessité pour pouvoir vivre et étudier. J’ai quitté Haïti pour venir à l’université de Laval. J’ai toujours rêvé de partir, comme 99 % des Haïtiens, peut-être même 100 %. Partir, c’est se réaliser. On se projette sur l’ailleurs. En Haïti, lorsque je voulais manger au restaurant, j’allais manger dans des restaurants étrangers comme « Les cèdres du Liban »… Les noms me faisaient rêver. Je mangeais tout ce qui n’était pas haïtien.
L’exil a amené une tension, une pulsion de vie et de mort. Un proverbe créole haïtien dit « Dèyè mon gen mon », « derrière la montagne il y a encore d’autres montagnes ». Ainsi après la joie viennent d’autres joies et après la peine d’autres peines. Je vis dans une double scène de représentation. J’existe à la fois en créole et en français. Mais ce qui se dit en créole n’est pas ce qui se traduit en français.
Je crois écrire en français, cependant il y a beaucoup de choses en dessous de la langue et ce n’est pas du français. Par exemple, il y a dans le créole des sauts et des télescopages que l’on fait naturellement. Une fois traduits cela devient des figures de style en français, alors que c’est naturel en créole.
Le créole est une langue qui accepte la présence de mystères. Par exemple, lorsque tu dis : Jeannette a disparu. En français, dans une société rationnelle, on va t’interroger. En créole, on comprend sans poser de questions. Dans une société où les gens vivent de contrariétés en contrariétés, le mystère est accepté. Ils se disent que c’est peut-être le vaudou.
C’est aussi une société où on est prêt à tenter l’impossible. Je pense à la joie de l’enfance. Les enfants ont une telle soif de savoir qu’ils sont capables de faire des kilomètres pour aller à l’école. J’ai vu des enfants qui descendaient la ville, parcourant quelque 40 km pour y aller. En remontant, ils courraient aussi et s’arrêtaient lorsqu’ils pouvaient pour cueillir des mangues.
Etre un résistant
« Allez-vous-en avec vos bontés », « j’écris de la main gauche / Pour que l’orage engrosse les mots / Pour que les esprits lavent ma tête », écrivez-vous dans Je suis la fille du baobab brûlé. Votre écriture exprime la colère et l’urgence. Vous écrivez « pour ne pas mourir » et « pour semer les milices ». Vous êtes un résistant qui réclame d’« exister vivant parmi les vivants, utopie que je signe et hurle » (Nous ne trahirons pas le poème).
L’exil est une tension. Un décalage qui a beaucoup nourri ce que j’écris. Cela fait que j’ai un usage modéré du monde. Ce qu’on a n’est rien. Il suffit d’un hasard pour qu’on habite à Haïti, à Paris ou à Dakar… La vie est un hasard. Moi-même je vis dans plusieurs pays, avec des situations paradoxales. Quand je vois ma fille et son rapport au pain et celui d’une fille haïtienne, ou bien quand je vois tout ce que j’ai ici à Montréal en termes de richesses, je sens en moi une colère. Pourquoi y-a-t-il cette distance entre deux êtres humains, deux pays ? En Haïti tout tombe et tout est urgent. Les gens meurent. Cette colère est le témoignage de mon impuissance. Je regarde la bêtise humaine à laquelle je participe par mon silence, mon exil et ma fuite.
À travers l’exil, je vis une pulsion de mort. Il y avait une urgence à m’exiler. J’ai dû traverser la montagne et la mer, lutter pour la moindre chose. En faisant cela j’ai appris que la mort existait. C’est le savoir des guerriers. C’est donc le prix à payer.
En vivant à Montréal, j’ai perdu la candeur de vivre dans le pays où vivait ma grand-mère, où je pouvais me cacher et où quelqu’un pouvait me tendre la main.
Pour les exilés haïtiens, il n’y a pas d’arrière-pays, car Haïti n’a pas besoin de nous. Sauf pour aider, mais qu’est-ce que je vais amener ? Des livres et de l’argent. Mais quand j’arrive on me dit, « tu vas retourner quand chez toi ? »
J’envoie les livres que je publie. Haïti est le seul endroit où quelqu’un m’a parlé de Mahmoud Darwich en récitant un de ses poèmes. Là-bas, ce ne sont pas les livres que les jeunes recherchent, car dans les livres, ils découvrent la route du monde. Ils cherchent le poème, la route, une poétique de l’autre, un meilleur usage du monde. C’est tellement fragile, le sentiment d’urgence.
Lorsque je vivais en Haïti, je connaissais par cœur les textes d’Aimé Césaire. C’était comme un jeu. Là-bas, on n’a aucune certitude que les livres vont rester, alors on les incorpore. L’Occident nous a habitués à posséder des objets, mais en Haïti, les objets ne restent pas, ils sont subtilisés, effacés ou détruits. On ne croit même pas à la solidité de la maison car la terre est fragile. Il y a tellement d’imprévus. On dit « deux jours à vivre », car le troisième est la mort.
Porter l’espérance
Pourtant vous avez écrit : « se rappeler que tout serait un chant si on le voulait, si les mots et les phrases avaient la conviction d’un quelconque bonheur » (J’ai un arbre dans ma pirogue). Votre poésie est porteuse d’espérance et nous entraîne à vos côtés « de plain-pied dans la tendresse du monde » (Récitatif au pays des ombres). « As-tu trahi l’enfance ? », demandez-vous (Nous ne trahirons pas le poème).
Heureusement la tendresse et l’apaisement nous permettent d’équilibrer la douleur. La tendresse est ce qui nous sauve. Les femmes qui m’ont élevé m’ont donné « un grand goût », c’est à dire un grand appétit du monde. Le fait d’être, d’exister malgré la fragilité, c’est cela avoir le grand goût du monde. Ce n’est pas de la dévoration comme on l’apprend aux hommes qui dévorent tout et qui se veulent puissants. Ce n’est pas la guerre au détriment de l’autre.
J’ai eu de la chance car en Haïti il y a une absence des hommes dans les foyers. Les femmes gèrent les enfants et leur donnent la tendresse. Les hommes passent et donnent de l’argent s’ils en ont. S’ils n’en ont pas, ils deviennent furieux et « la honte devient leur colère ». Les grands-pères sont assagis et ramassent les pots cassés.
Ma grand-mère chantait les chants d’espérance. L’espoir est donc la tendresse des pauvres. Ces femmes se disaient : on va se mettre ensemble pour voir comment faire un homme de cet enfant. Dans une société où règnent la dictature et la violence, elles se sont demandées comment créer des angles morts, afin que l’enfant ne voit pas tout cela. L’église a joué un rôle. La foi, le rapport au sacré sont atypiques. Puisque le réel est absolument foudroyant et mauvais et qu’il est une condition d’échec, les femmes ont porté l’espoir en lisant la Bible et les psaumes qui chantent l’abondance. Elles m’ont permis de fermer les yeux sur les conditions d’existence réelles et m’ont donné la foi dans quelque chose de plus grand.
Revenir au pays natal
« Revenir au pays natal, au pays rêvé où j’ai rendez-vous avec mes ombres dans le rues ensoleillées, pour repartir avec provision de fantômes » (Récitatif au pays des ombres). Vous vous endormez ville et vous vous réveillez forêt (Nous ne trahirons pas le poème). « Cet arbre qui habite [votre] corps [vous] convoque » (J’ai un arbre dans ma pirogue). Votre écriture a la force d’une incantation rythmée par les tambours.
Les tambours portent les voix des « mille vies ». Les tambours sont toujours dans ma tête. La musique du vaudou est une musique incantatoire. Lorsque nous nous demandons comment faire quelque chose de ce réel pourri, le son du tambour nous permet d’aller plus loin. Il nous guérit du malheur. Le chant nous grandit.
Dans le chant, il y a toujours un autre chant. En Haïti, lorsque jouent les tambours, à l’intérieur du grand tambour il y en a un autre plus petit. C’est comme s’il y avait du bruit et qu’à l’intérieur tu entendais un rythme. Sous le rythme du « gros ka » (ou « gwoka »), il y a un son. Au-dessus, il y a toutes les rumeurs et dessous un son plus discret et plus sensible. Un contrepoint que tu entends si tu prêtes l’oreille. Toute la puissance vient de cet effort d’attention au plus ténu. Alors tu entends la voix des ancêtres.
Il faut être prêt à les accueillir. Se mettre dans une disposition d’accueil.
Je travaille beaucoup sur les instruments comme le tambour. Pour vivre, nous avons besoin de silence. Dans ce pays où la chambre à soi n’existe pas, comment peut-on se retrouver malgré tout en tant qu’individu ? Il ne faut pas ajouter du bruit au bruit.
En Haïti, l’histoire n’est pas constituée comme en Occident. L’effort mémoriel à faire pour retourner à hier, au passé, est difficile car le présent est très prégnant. La vie quotidienne est rude. Rien n’est donné. Il faut aller chercher l’eau et le feu. Le combat est pour le présent.
Cependant, nous avons la nuit. La nuit, la parole et le conteur. Les contes nous sauvent. La nuit amène une autre dimension qui n’est pas le combat pour l’eau et la survie. La nuit, un autre corps se développe. D’autres yeux nous viennent. Des identités différentes. Il y a un être pour le jour et un autre pour la nuit. Lorsque nous faisons surgir un autre corps en nous, alors les esprits prennent possession de nos corps. Nous incarnons l’arbre et la forêt.
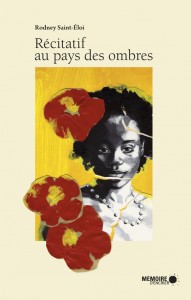
« Port-au-Prince tête chargée
ville tôles rouillées
ville plastique
ville dos bas
ville Give-me-five-cents
toutes les cloches sont inondées
les portes se referment sur les souvenirs
la terre dort dans la paresse des nuages
Port-au-Prince marque la mesure du temps
l’eau à battre à la rivière espoir
demain à verser au passif des décombres
Port-au-Prince ville entre les villes
ville scellée aubes tranquilles
Port-au-Prince ville sept carrefours
ville mille métiers mille misères »
Récitatif au pays des ombres, 2011
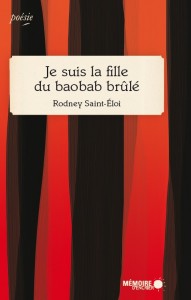
« Elle jette son corps sur le sable blanc
Elle suit la gazelle qui lèche sa peau
Quatre directions l’horizon
Le cœur bat fragile
A chacun ses navires de papier
Ses ciels aux trompettes bleue
Et ses comptes en souffrance
Le temps des promesses d’amour
La grossesse des vents d’est
La détresse des mers frappées
Le suicide des abeilles au printemps »
Je suis la fille du baobab brûlé, 2015


Cet entretien rend son d’homme et donne envie de connaître et l’homme et le poète.
Il régénère, merci !